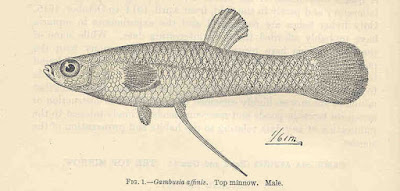Les premiers pas dans le monde de la science sont toujours une expérience inoubliable. Aujourd’hui, Perrine, une jeune étudiante, est invitée sur notre blog pour vous raconter son premier stage de terrain.
L’Ariège. Terre inconnue, mystérieuse, et lointaine, elle fut ma terre d’accueil pendant les trois mois d’été de l’année 2019. Ce n’est pas pour aller observer les ariégeois et leurs coutumes que je me suis déplacée si loin de la Nièvre mais bien pour pêcher des truites fario (Salmo truita). C’est donc à la Station d’Écologie Théorique et Expérimentale du CNRS (SETE) à Moulis que je débarquais par une magnifique journée d’été avec mon bagage d’étudiante agronome, pour participer à un projet scientifique incroyable.
Pêcher des truites, très bien, mais pour quoi faire ?
Les fédérations de pêche d’Occitanie se sont alertées ces dernières années quant à l’augmentation de la mortalité des truitelles (bébés truites). Cette mortalité semble directement liée à la présence de Tetracapsuloïde bryosalmonae, un parasite cnidaire des salmonidés (appelons-le plus simplement “le parasite” pour le reste de l’article), et qui provoque une maladie infectieuse : la maladie rénale proliférative, plus communément appelée PKD (pour l’anglais Proliferative Kidney Disease).
Le parasite prolifère et se multiplie dans les bryozoaires, des organismes aquatiques filtreurs formant des colonies sur différents substrats d’eau douce tels que des roches ou des algues. Quand les conditions sont propices, les bryozoaires infectés libèrent le parasite dans l’eau. Le parasite va ensuite pénétrer sous forme de spores à travers la peau et les branchies dans les muqueuses des truitelles, son second hôte. Il va atteindre les reins et la rate de l’alevin via la circulation sanguine, où il va continuer son développement. La truitelle libérera les spores du parasite en urinant, et ceux-ci pourront coloniser de nouveaux bryozoaires, et ainsi de suite.
 |
| Cycle de vie du parasite Tetracapsuloides bryosalmonae (reproduction : SLS Nadler, Küsnacht) |
Seulement, chez les truites, le rein a une fonction dans le transport de l’oxygène. Lorsque le parasite s’y multiplie, le rein grossit, dysfonctionne, et peut causer la mort de la truitelle par asphyxie. Dans 10 à 90% des cas, la truitelle meurt (Sudhagar et al. 2020). Ce parasite était déjà connu des fédérations de pêche, mais jusqu’il y a quelques années, la mortalité des truitelles due à celui-ci était encore modérée. C’est l’augmentation de la mortalité des truitelles due au parasite qui a amené Simon Blanchet, chargé de recherche en Ecologie aquatique au CNRS, et Eloïse Duval sa doctorante à se pencher sur la question.
Leur projet de recherche s’attache à étudier la distribution, la dispersion, et les impacts du parasite sur les populations de truites fario et à comprendre les causes de cette soudaine hausse de la mortalité, qui met en péril la pérennité des populations sauvages de la région. Et j’ai eu la grande chance d’intégrer cette équipe et de les aider pendant quelques temps à faire avancer le projet.
Le protocole de recherche
Le projet est vaste et ambitieux : il s’agit de prélever et d’étudier des truitelles de près de 50 sites, ciblés par les fédérations de pêche, et répartis sur tout un tas de cours d’eau un peu partout en Occitanie !
 |
| La région Occitanie couvre une bonne partie du sud de la France (Source) |
La truite fario est une espèce appartenant à la famille des salmonidés, grandissant en eau douce. Elle se reproduit entre novembre et février dans une eau fraîche entre 5° et 12°C. Après l’éclosion au printemps, les juvéniles commencent à se disperser et se déplacer vers l’aval des cours d’eau, vers des zones de la rivière adaptées à leur taille et besoins. Ils s’installent plutôt dans les radiers et les plats courants, des zones peu profondes avec un courant à vitesse moyenne.
En pêchant en été, nous pouvions donc cibler les truitelles âgées de moins d’un an, de taille inférieure à 10 cm, qui sont les plus susceptibles de développer la PKD. Ainsi sur chaque site nous échantillonnions environ 20 truitelles par pêche électrique, et nous faisions sur chacune d’entre elles différentes mesures.
Comment se déroule une journée de terrain ?
Chaque matin, nous vérifions que tout le matériel est présent dans le Ranger : la quantité à y entasser est FARIOMINEUSE (vous l’avez ??). Ensuite, une fois sur site, nous les stagiaires néophytes et les personnes expérimentées comme Simon, allons pêcher.
Avant de s’aventurer dans l’eau il faut s’équiper : Waders, chaussures à crampons antiglisse, épuisettes, seaux, anode, cathode et groupe électrogène. L’anode (le pôle négatif) est une sorte de perche dotée d’un anneau conducteur qui sera agitée dans l’eau par un membre de l’équipe, et la cathode (le pôle positif) est une « corde » qui baigne dans l’eau en permanence. A vrai dire, les waders sont devenus ma seconde peau pendant l’été. Adieu la sexytude, mais cela vaut mieux si vous ne voulez pas vous prendre une châtaigne. Car la pêche électrique n’a rien d’une petite baignade tranquille en eau douce et à la canne à pêche, cela peut être assez dangereux. Mais cela s’est toujours bien passé dans mon équipe, le COURANT passait bien entre nous.
Une pêche électrique se déroule à peu près ainsi : les épuisettiers (mot inventé pour l’occasion) se mettent de part et d’autre de la personne qui porte le groupe électrogène et l’anode, à l’affut des malheureux poissons. L’exercice n’est pas facile, les truitelles assommées sont emportées rapidement par le courant et me passent souvent sous le nez. Ou atterrissent plus volontiers dans l’épuisette de mes camarades.
 |
| Sur le terrain, on s'organise en différents postes de travail (Crédit : Pierre Girard) |
 |
| La pêche électrique est quand même bien plus efficace que la pêche à la ligne ! (Crédit : Pierre Girard) |
Aucune pêche ne se ressemble. De fait, chaque cours d’eau a ses caractéristiques propres : sa taille, la turbidité (degré de transparence) de l’eau, la vitesse et la force du courant, la structure et la texture du sol, la température et autres paramètres physico-chimiques, la composition de la végétation environnante… En conséquence, la difficulté à pêcher varie. Parfois nous mettons 15 minutes pour pêcher nos 20 truites et d’autres fois c’est la dèche, il nous faut 40 minutes pour en avoir à peine la moitié. Nous enregistrons d’ailleurs les caractéristiques physico-chimiques de chaque cours d’eau à l’aide d’une sonde et d’un thermomètre.
Une fois nos 20 truitelles capturées, elles sont chacune mises dans une bouteille d’eau, et puis elles vont y rester pour y faire pipi tranquillement. Oui j’ai bien dit faire pipi. Notre protocole se base sur la détection d’ADN environnemental (ADNe) : ceci consiste en la filtration de l’eau des bouteilles grâce à des pompes reliées à des portes-filtres montés à la main et … à l’huile de coude. L’ADN contenu dans la bouteille, rejeté par l’alevin lors de la miction (c’est le mot scientifique pour dire qu’on fait pipi, vous pourrez toujours le replacer lors d’un diner de famille assommant pour vous éclipser aux toilettes d’une manière élégante), va se déposer sur le filtre. Ensuite, lors des analyses de biologie moléculaire, on pourra isoler l’ADN du parasite si présent, grâce à une séquence connue de son génome.
 |
| Notre système de filtration d'ADNe (Crédits : Daniel Estrade) |
 |
| Capture colorimétrique d'une truitelle anonyme par photographie (Crédit : Eloïse Duval) |
Après le recueil de l’ADNe, des analyses complémentaires sont effectuées pour essayer d’établir des liens entre les caractères observables de l’individu (son phénotype), sa composition génétique (son génotype) et sa contamination et résistance au parasite. Chaque truite « filtrée » est anesthésiée, puis est prise en photo pour faire une analyse colorimétrique. Elle est ensuite mesurée, pesée, et se fait prélever un morceau de nageoire pelvienne (si si, ça repousse). La truitelle se remettra de ses aventures dans un seau « réveil » avant d’être relâchée. La journée finie nous rentrons avec nos échantillons d’ADNe, de nageoires, et nos mesures. Ces échantillons seront envoyés en laboratoire pour être analysés à la fin de la saison de pêche et ils permettront l’élaboration de statistiques quant à la distribution et l’impact du parasite sur l’ensemble des cours d’eau ciblés.
Conclusion d’une stagiaire
Si trois mois de participation à ce projet scientifique ne m’auront pas transformée en pêcheuse aguerrie, j’aurai passé un été très enrichissant sur le plan scientifique et découvert les superbes paysages de l’Ariège sauvage. J’espère découvrir plus encore le monde de la recherche et pourquoi pas dans d’autres domaines de l’écologie.
 |
| Quelques photos de l'Ariège (si vous cherchez votre prochaine destination de vacances) |
L’objectif à long terme pour l’équipe avec laquelle j’ai travaillé sera de proposer des solutions permettant de réduire le nombre de pertes parmi les rangs de truitelles, victimes de ce parasitisme qui gagne en puissance. “L’équipe poisson” de Moulis fait un travail formidable et j’espère que les travaux de recherche permettront aux fédérations de pêche d’Occitanie de mettre en place des solutions pérennes qui auront pour but de préserver ces petites truitelles. Affaire à suivre !
References :
- Sudhagar, A.; Kumar, G.; El-Matbouli, M. The Malacosporean Myxozoan Parasite Tetracapsuloides bryosalmonae: A Threat to Wild Salmonids. Pathogens 2020, 9, 16.
- Fédération Départementale de Pêche de l’Ariège (FDPA) : infos sur la PKD dans la rivière Arièg
Pour en savoir plus sur les projets de l’équipe et de le SETE :
Perrine HUET