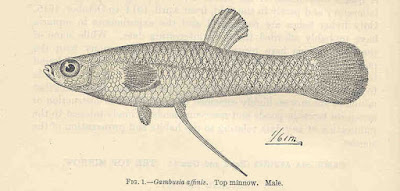Quel joyeux titre en cette période suivant les fêtes … non ne partez pas tout de suite ! Aujourd’hui, on va parler de changements climatiques à court terme, et particulièrement de ce qui va nous arriver dans la poire dans les quelques dizaines d’années à venir.
Pour cela je me suis basé sur l’article de Burke et al., paru cette année dans la revue PNAS.
Je ne vous apprends rien en disant que ça chauffe sur la planète : le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat, en anglais
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change) stipule que d'ici 2030 à 2052, l’augmentation de température à l’échelle de la planète atteindra 1,5°C, compte tenu des tendances actuelles de l’humanité à émettre du CO2 (qui, je le rappelle, est un gaz à effet de serre ayant un impact direct sur le changement climatique). Donc, ça n’est pas prévu pour le siècle prochain, non non. Mais bien dans quelques décennies… voire bien plus tôt que ça, en fait.
Pour rappel, une augmentation aussi rapide de la température globale aura un impact direct sur – dans le désordre – les régimes de précipitation, la fonte des glaciers et la montée du niveau des océans, l’augmentation significative des épisodes d’inondations, l’accroissement en force et en fréquence des tempêtes tropicales et des ouragans, l’aridification des terres arables, l’acidification des océans, etc. Ce qui aura pour conséquence – au choix – l’altération des productions agricoles, une augmentation des flux migratoires des populations, la disparition de certaines villes sous les eaux, etc., etc.
Je continue ?
Alors, en termes de réjouissances, à quoi devons nous nous attendre au juste ? Parce que c’est bien beau de se dire que le climat va changer, mais ça serait quand même chouette de savoir comment, pour pouvoir passer ses dernières vacances dans un coin tranquille avant l’apocalypse (moi, sarcastique ? jamais voyons). Ça tombe bien, parmi les nombreuses études scientifiques qui parlent de ce sujet (c’est très en vogue en ce moment de parler du climat, on se demande pourquoi tiens), en voici une qui propose différents scénarios pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Mais avant de détailler les résultats de cette étude, on va faire un point météo.
Le climat a-t-il toujours été celui qu’on connait actuellement ?
Eh bien en fait… pas du tout. Notre petit cocon douillet climatique, tel qu’on le connait encore actuellement et depuis que l’humanité garde trace de ses observations sur la météo, ne représente qu’une infime portion de ce qu’a pu être le climat au cours de l’existence de la Terre.
Sans nécessairement remonter aux temps anciens (genre quand les océans n’existaient pas et que la Terre était une grosse boule de lave en fusion, lors de sa formation au sein du système solaire il y a quelque chose comme 4.5 milliards d'années, à la louche), on peut distinguer plusieurs périodes spécifiques durant lesquelles le climat de notre chère vieille planète n’était pas franchement celui d’aujourd’hui. Spécifiquement, au cours de l’histoire « récente » de la Terre, on distingue quelques périodes au cours desquelles se promener en bikini en Alaska était assez courant. Pour autant que l’Alaska ait existé à cette époque et que les bikinis aient été inventés, mais ceci est un détail.
Mais comment peut-on savoir que les températures étaient réellement différentes ? Clairement les stations météo de l’époque étaient inexistantes (je vois mal
Evelyne Dhéliat faire le détail des prévisions météo). Pour remédier à cela, on utilise des techniques d’enregistrement du climat dans les glaces polaires, au moyen des isotopes stables. Pas de panique, je vous explique.
L’enregistrement du climat sur cassette VHS
Tous les éléments qui nous entourent sont constitués d’
atomes, je ne vous apprends rien. Ces atomes sont caractérisés par leur numéro atomique, qui correspond au nombre de protons (particules chargées positivement), et par le nombre de masse, qui correspond à la somme du nombre de neutrons (particules non chargées) additionnés de celle des neutrons. Si le numéro atomique définit la nature de l’atome (hydrogène, oxygène, carbone, etc.), il peut s’avérer que deux atomes du même élément possèdent un nombre de masse différent. C’est le cas si par exemple un atome d’oxygène, dont le noyau est constitué habituellement par huit protons et huit neutrons, et qui se note
16O, se retrouve affublé de deux neutrons supplémentaires, ce qui se note
18O. L’oxygène
18O est ce que l’on appelle un isotope stable de l’oxygène
16O. Ces deux isotopes stables possèdent une masse différente (et par conséquent, un poids différent, vu que le poids est corrélé à la masse), du fait de la présence de deux neutrons, ajoutant une masse : l’isotope
18O qui se trouve donc plus lourd que l’isotope
16O …
Mais quelle importance dans notre cas ? Que viennent faire ces isotopes dans notre étude du changement climatique ? Patience, patience, j’y arrive ! Pensez à présent que l’oxygène peut se combiner avec l’hydrogène afin de former des molécules d’eau H
2O, présentes en grande quantité sur Terre. Fondamentalement, une molécule d’eau comportant un atome de
18O va être légèrement plus lourde qu’une molécule comportant un atome de
16O… et ça, c’est la clé pour pouvoir mesurer les variations climatiques sur le long terme. Eh oui ! Car une molécule d’eau « lourde », c’est-à-dire qui comporte un atome de
18O, va avoir tendance à rester sous forme liquide (principalement l’eau des océans) plus facilement qu’une molécule d’eau « légère », c’est-à-dire qui comporte un atome de
16O. Les molécules d’eau qui subissent l’évaporation et le passage sous forme de vapeur d’eau (qui, je le rappelle, est un gaz), vont contenir respectivement moins de
18O que de
16O. Particulièrement, en période froide, lorsque l’évaporation est moins fréquente, les atomes de
18O vont être plus présents dans les océans, au détriment de l’eau présente sous forme de vapeur. Au final, la quantité de
18O dans l’eau vapeur va être appauvrie par rapport à celle située dans l’eau liquide, en période froide. Et c’est cette variation de la quantité de
18O dans la vapeur d’eau, directement associée à la température ambiante, qui est notre enregistrement climatique ! En effet, c’est à partir de la vapeur d’eau que se forment les précipitations, particulièrement les chutes de neige responsables de la formation des glaciers (aux pôles ou dans les hautes montagnes). La proportion de
18O dans les glaciers, directement dépendante de celle présente dans l’eau atmosphérique responsable des précipitations, sera alors emprisonnée successivement au cours des années, suite aux dépôts de précipitations les unes par-dessus les autres.
De la même manière, il est possible d’enregistrer les variations climatiques dans les sédiments marins, formés entre autres à partir des coquilles des animaux morts déposés sur les fonds marins (la craie des falaises calcaires de Normandie est un très bel exemple de sédiment marin). Les coquilles étant constituées de carbonates de calcium CaCO
3, donc comportant trois atomes d’oxygène, on applique ici le même principe lié aux isotopes ayant des masses différentes, comme pour les glaces, à la différence ici que la relation est inversée. En effet, comme je le disais plus haut, le
18O va être retenu dans l’eau des océans particulièrement en période froide car il va être moins soumis à l’évaporation, étant plus « lourd » que le
16O. Par conséquent, les carbonates formés durant les périodes froides seront plus riches en atomes de
18O comparativement à ceux formés en période chaude.
On peut ainsi remonter très loin dans les climats du passé en étudiant les couches successives de glace et de neige déposées au cours du temps dans les glaciers, ainsi que des couches de sédiments marins. Ce principe nous permet ainsi de reconstituer les climats passés en faisant un lien direct entre les quantités de
18O et la température passée correspondante. C’est à l’aide ce fabuleux outils qu’on a pu déterminer qu’au cours de l’histoire de la Terre, le climat n’avait pas toujours été tel qu’on le connait actuellement.
Le climat à l’Eocène sous le sunlight des tropiques
Sur une échelle géologique dans l’histoire de la Terre, l’Éocène c’était hier. Bon, j’exagère, peut être avant-hier. Officiellement, selon la
Commission Internationale de Stratigraphie, l’Éocène est une période allant de 56 à 34 millions d’années avant notre ère. Dis comme ça, ça semble proche, mais il faut s’imaginer que le
premier fossile connu rattaché à l’espèce humaine a été daté de 300.000 ans (soit, pour remettre ça à la même échelle de temps, 0.3 millions d’années). Donc, pas si proche que ça de nous, mais comparé à l’âge de la Terre c’est une poussière.
En tout cas, à l’Éocène, le climat global de la planète était particulièrement… chaud bouillant. Les enregistrements des sédiments de l’époque montrent que la température globale de la planète était – selon les estimations – de 5 à 8 degrés Celsius supérieurs à ce qu’on connait actuellement. Clairement, la Terre avait un autre visage et c’était plutôt dans l’esprit du Club Med’, séjours Caraïbes un peu partout sur la planète : pas de glace du tout aux pôles et des températures tropicales à des latitudes aussi élevées que le nord de l’Europe. Vous imaginez, bronzer les doigts de pieds en éventail sur une plage en Ecosse ? Non, moi non plus… mais force est de constater qu’à l’époque c’était tout à fait vraisemblable. Pour tout vous dire, la Terre ressemblait à ça :
 |
| La Terre reconstituée à l'Eocène - source |
Pas une trace de glace aux pôles, des eaux tropicales un peu partout sur la planète, et des êtres vivants en conséquence (c'est à dire adaptés à des conditions de vie tropicales). Par la suite, le climat s’est un peu refroidit, et la Terre a commencé à ressembler à ce que l’on connait actuellement, mais un autre passage au cours de son histoire s’est avéré intéressant : le Pliocène, situé il y a environ 3 millions d’années.
Le Pliocène : pense à ton écran total
Ce qui est particulièrement frappant
(ouille) au Pliocène, c’est la quantité de CO
2 présente dans l’atmosphère à l’époque. Bon, dis comme ça… ce n’est pas évident. Mais, si je vous dis qu’à cette période, la quantité de CO
2 – qui est un gaz à effet de serre, entre autres responsables du changement climatique actuel – était de 400 ppm (partie par million), soit constituait 0.04% de l’atmosphère, ça ne vous dit rien ? Non, toujours rien … Eh bien, 400 ppm de CO
2, c’est exactement la quantité qui vient d’être atteinte pour ce gaz,
au cours de notre ère industrielle. Ce qui signifie, en clair, que la concentration de CO2 actuellement présente dans l’atmosphère vient d’atteindre celle qui était présente au Pliocène. Et à cette époque, le climat était particulièrement aride, avec des sécheresses intenses à l’échelle de continents entiers. Là on ne parle pas de canicule… mais bien de surfaces entières brûlées par le soleil et balayées par des vents torrides lors des mois les plus chauds, avec peu de précipitations pendant les mois les plus froids pour contrebalancer le tout. Sexy hein ? Pas trop non.
Retour vers le futur climatique ?
D’après les estimations des auteurs Burke et al. 2018, si la tendance actuelle se poursuit en termes de production de CO2 atmosphérique, directement lié à l’augmentation globale de la température, on pourrait aboutir à la succession de deux scénarios climatiques. D’abord, d’ici 2030, on aurait un retour du climat terrestre vers celui observé au cours du Pliocène, donc extrêmement aride, accompagné par une augmentation des températures globales entre 1,8 et 3,6 degrés plus chaudes qu’actuellement, sans oublier une fonte des glaces aux pôles accélérée et par conséquent, une augmentation du niveau des mers. Donc, adieu les villes côtières comme New York ou Londres, sans oublier tous les archipels d’îles dans le Pacifique qui verraient leur surface se réduire jusqu’à disparaitre sous les eaux.
Et ce n’est pas fini ! D’ici 2050 à 2140 (ici la
fourchette est un peu plus large), on verrait revenir à la surface de la Terre des climats dignes de l’Éocène, avec des faunes et flores tropicales provenant des zones équatoriales qui supplanteraient les faunes et flores tempérées actuelles à des latitudes élevées et une absence totale de glaces au niveau des pôles. Ici, les changements ont lieu dans un laps de temps si court que les espèces n’auront pas ou peu la possibilité de s’adapter sur place à leur nouvel environnement : elles devront suivre les conditions climatiques pour ne pas disparaitre. L’avenir s’annonce donc particulièrement chaud, avec des températures qui chambouleront tous les écosystèmes terrestres et marins tels que nous les connaissons.
Sur la plage ensoleillée, coquillages et crustacés se font cuire au court-bouillon
Ici s’arrête notre analyse scientifique de la situation : on sait pertinemment qu’on se dirige vers des changements climatiques drastiques, et à présent on est même capable d’imaginer clairement à quoi ressembleront nos conditions environnementales par comparaison avec ce que la Terre a déjà connu par le passé. En clair, il va faire chaud !
D’un point de vue plus personnel, je tenais à terminer sur une réflexion qui n’engage que moi à propos du changement climatique. D’une part, l’humanité sera – et est déjà – responsable de la disparition de nombreux écosystèmes et espèces uniques, qui auront des impacts directs sur le bien-être des populations humaines : sans dresser une liste exhaustive, je pense à la perte potentielle de nouvelles molécules à usage médical qui pourraient se trouver dans les plantes des forêts tropicales indonésiennes, actuellement défrichées pour y installer des plantations de palmiers à huile ; ou encore, le pompage compulsif de l’eau du Mississippi aux États-Unis, qui engendre des sécheresses épouvantables dans des endroits auparavant naturellement irrigués ; ou bien la perte des récifs coralliens suite à l’acidification des océans, ayant des conséquences directes sur la protection des rivages adjacents où habitent un grand nombre de personnes. Pour finir, il me semble probable que notre société actuelle ne puisse pas faire face à tous ces changements et qu’en conséquence, elle finisse par s’effondrer, suite aux – trop – nombreuses manifestations d’un climat changeant (sécheresses répétées, ouragans et tempêtes tropicales violents, perte des surfaces cultivables, etc). Attention, je ne dis pas que l’humanité en tant qu’espèce
Homo sapiens va disparaitre, mais que notre système entier sera grandement chamboulé par tous ces changements globaux.
Et sur une note plus positive, eh bien… disons qu’on pourra profiter de la plage à Dunkerque en plein mois de décembre sans risquer de se geler les orteils !