L’autre jour, j’ai eu la chance
d’assister à une conférence du botaniste Francis Hallé, sur les comparaisons
entre plantes et animaux. Entre autres choses, M. Hallé est à l’origine du
projet « radeau des cimes » qui vise à étudier la canopée des forêts
tropicales humides par le dessus (et c’est quand même ultracool). Mais ce qui
m’a interpellé, lors de cette conférence, c’est cette affirmation : les
plantes à fleurs, telles que nous les connaissons, n’ont pas besoin des animaux
pour vivre, évoluer, se reproduire, se nourrir. Alors, je suis d’accord que la
plupart du temps, en effet, les animaux sont prédateurs des plantes – brouteurs
surtout – mais il est un cas pour lequel je suis en désaccord avec M. Hallé, et
c’est le cas des rapports des plantes avec leurs pollinisateurs.
 |
| Quelques exemples des animaux capables de polliniser les plantes à fleurs. En haut, à gauche, une abeille sur une Salvia; en haut à droite, un syrphe sur un Caltha; en bas à gauche un colibri, en bas à droite une chauve souris avec une Gesneriaceae. |
L’ayant fait remarquer à M. Hallé, celui-ci répondit par l’affirmation qu’à terme, si les pollinisateurs disparaissaient, certaines espèces végétales en souffriraient et s’éteindraient probablement, mais que la grande majorité des végétaux n’en serait pas ou peu affectée. Alors, peut-être que cela sera le cas dans le futur – et avec tous les soucis actuels liés à l’empoisonnement des abeilles par les pesticides utilisés en agriculture intensive, on est bien partis pour observer une réelle diminution des production agricoles où la pollinisation par ces insectes joue un rôle important – et ça personne ne peut le prédire, mais ce qui m’intéresse ici, ce n’est pas ce qui va se passer, mais ce qui s’est déroulé il y a bien longtemps… au Crétacé. Car c’est à cette époque que les premières plantes à fleurs sont apparues – selon les dernières datations et fossiles retrouvés. Ce qui est intriguant ici, c’est que dès leur apparition, les angiospermes ont subit une explosion de diversification, jusqu’à devenir le groupe de végétaux majoritaire sur Terre en termes de nombre d’espèces et d’individus. Et je me demande, les plantes à fleurs ont-elles « explosé » ainsi toutes seules, ou bien ont-elles été aidées… par leurs pollinisateurs ? On parle en effet beaucoup de coévolution entre les plantes et les insectes actuellement, mais qu’en était-il au tout début ? Quelle est la part du rôle des insectes et autres pollinisateurs dans l’évolution des plantes à fleurs ?
Au commencement…
L’apparition des plantes à fleur
a posé un gros problème conceptuel à Darwin lorsqu’il a pensé sa théorie de
l’évolution. En effet, dans la majorité des groupes d’êtres vivants, Darwin
constate une apparition graduelle des caractères au cours de l’évolution, qui
permettent de relier les groupes entre eux. Le problème, chez les plantes à
fleurs, c’est qu’il n’y a,à première vue, aucune structure intermédiaire de
« fleur » pouvant expliquer son apparition et le tâtonnement de l’évolution
au cours du temps : on passe d’un système de reproduction sans fleurs à un
système où les fleurs deviennent le moyen majoritaire de se reproduire. Cela
semble totalement aberrant pour Darwin, pour qui l’évolution est graduelle et
faite progressivement ; or dans le cas des plantes à fleurs, elle semble
rapide et menant directement à une structure florale extrêmement constante et
bien établie.
Pour expliquer cette absence de gradualisme, Darwin propose l’hypothèse suivante : les plantes à fleurs se sont développées sur un continent maintenant disparu, ce qui entraine une absence de fossiles qui auraient pu donner des exemples de morphologie intermédiaire. Par la suite, les angiospermes auraient migré sur les autres parties de la Terre, pour coloniser tous les milieux possibles.
Un scientifique contemporain de Darwin, nommé Saporta, émet quant à lui une autre hypothèse novatrice pour l’époque. Il part de l’observation que certains groupes d’insectes, actuellement diversifiés et possédant des interactions avec les plantes à fleurs, ne se retrouvent pas dans le registre fossile de l’époque pré-angiospermienne. Il propose alors que les plantes à fleurs aient co-évolué avec d’autres groupes animaux, de manière fulgurante, au Crétacé : il s’agit d’une des premières conceptualisations des variations de taux de diversification au cours de l’évolution, chose qui pour Darwin n’est au départ pas concevable – il considérait que l’évolution avait une vitesse constante pour tous les organismes, or on s’est aperçu plus tard que c’était loin d’être le cas. Darwin va se montrer très enthousiaste lorsque Saporta lui suggère cette idée, et s’empresse de la considérer comme l’hypothèse la plus plausible pour expliquer son « abominable mystère ».
Alors, peut-on considérer que l’origine des angiospermes est avant tout un « saut évolutif », sans processus graduel, ou bien manque-t-il effectivement des informations fossiles pour nous permettre d’avoir une vue d’ensemble plus exacte ?
Un scénario probable
Traditionnellement, l’apparition
des plantes à fleurs sur Terre est datée du Crétacé, aux alentours de 130 millions
d’années (Herendeen et al 2017), même si la datation moléculaire tend à
reconstruire l’âge d’origine des angiospermes comme antérieur au Crétacé. Avant
cette époque, aucune trace fossile certaine et non-ambigüe n’existe pour
attester de la présence des angiospermes. De nombreuses études sont penchées
sur la question de cette apparition soudaine, et il en ressort que l’explosion
évolutive des plantes à fleurs puisse s’expliquer par une forte relation avec
les insectes. Même si de nombreux groupes d’insectes étaient déjà présent avant
l’apparition des plantes à fleurs sur Terre, on sait que lorsqu’un insecte
consomme du pollen, il en est également le vecteur pour la pollinisation. C’est le
cas par exemple du groupe des Coléoptères, qui étaient des pollinisateurs
potentiels pour les premières plantes à graines comme les fougères à graines ou
les gymnospermes. On retrouve même certains fossiles d’insectes qui possèdent
du pollen stocké dans leur estomac !
Les insectes possédant des caractères strictement liés à la nutrition grâce aux fleurs, comme les longues trompes (proboscis) permettant d’aller chercher le nectar au fond de la corolle, n’apparaissent qu’à partir du Crétacé, soit en même temps que les premières angiospermes. On observe une diversification des lignées comprenant les abeilles, les guêpes, les bourdons, les syrphes, bref, tous les pollinisateurs les plus actifs à l’heure actuelle. On peut donc parler ici d’une coévolution et co-radiation* des insectes pollinisateurs et des plantes à fleurs. Mais quant à savoir qui a été le premier à entraîner la diversification de l’autre, pour le moment, on ne peut rien en dire !
*en biologie, on parle de
radiation évolutive pour décrire l’apparition de nombreuses lignées sœurs sur
laps de temps très court
Les fleurs ancestrales pollinisées par les insectes ?
En évolution, on se sert
principalement des arbres phylogénétiques (graphiques permettant de représenter
les liens de parenté entre les organismes vivants) pour tester tout un tas de
scénarios évolutifs et pour reconstruire l’apparition de certains caractères.
L’étude de Hu et al (2008) utilise ce principe : les chercheurs se sont
basés sur la phylogénie connue des plantes à fleurs – autrement dit, les
relations évolutives entre les différentes familles actuelles de plantes à
fleurs – afin de modéliser l’évolution des modes de pollinisation au cours du
temps. C’est seulement par la suite au cours de l’évolution que le mode de
pollinisation par le vent s’est développé jusqu’à parfois devenir majoritaire
dans certains groupes, alors que la pollinisation par les insectes est
considérée comme ancestrale.
Bon, vous me direz, tout ça, c’est seulement des conjectures, pas forcément vérifiables puisqu’il s’agit de choses qui ont eu lieu il y a très longtemps. Sauf que les chercheurs n’en sont pas restés là : ils ont aussi analysé des agrégats de grains de pollens, retrouvés dans les couches sédimentaires. Par comparaison avec ce que l’on trouve de nos jours, ces agrégats sont caractéristiques de la pollinisation par les insectes. En effet, les fleurs pollinisées par les insectes vont avoir tendance à produire ce type de pollen collant et visqueux. La présence de ces agrégats, dès le Crétacé moyen – âge supposé de l’apparition des plantes à fleurs – est donc un indice supplémentaire permettant de dire que les premières fleurs étaient pollinisées par les insectes.
Qui de l’insecte ou de la fleur est apparu en premier ?
Bon, en vrai dans notre cas, il
faudrait dire « Qui de l’insecte ou de la fleur s’est diversifié en
premier ? ». Pour revenir à notre question initiale, nous ne savons
toujours pas si ce sont les insectes qui ont enclenché la diversification des
plantes à fleurs en devenant pollinisateurs, ou bien le contraire, c'est-à-dire
si l’apparition des plantes à fleurs a augmenté la diversification des
insectes.
Regardons à présent l’aspect génétique de la chose. Chez les plantes à fleurs, il est courant d’observer des duplications du génome, encore appelé polyploidisation. Ce sont des évènements aléatoires, qui génèrent de la diversité génétique de manière ponctuelle. Souvent, ce phénomène est associé à l’apparition de nouvelles fonctions – au niveau du génome ainsi que de la morphologie. Plusieurs lignées peuvent aussi subir plusieurs évènements de polyploidisation indépendants successifs. Il n’est donc pas incongru de penser, comme l’équipe de DeBodt et al (2005) le propose, que la diversité de forme et de fonction des plantes à fleurs est potentiellement due à des évènements de duplication du génome au cours de l’évolution. La présence de la fleur telle que nous la connaissons serait donc, d’après eux et d’après de nombreuses autres études, le résultat d’une duplication des gènes. Si l’on considère cette hypothèse – étayée par les études des génomes de nombreuses plantes actuelles – alors en effet, les insectes n’auraient aucun rôle dans la diversification des plantes à fleurs au cours du Crétacé.
… et pour finir
Mais alors, les insectes ne
servent à rien dans tout le processus de diversification des plantes à
fleurs ? Nenni !! Au contraire, ils sont fort utiles ! Il est
vrai qu’on ne peut pas être certain quant au rôle de ceux-ci dans la
diversification des plantes à fleurs au Crétacé – et la question restera
probablement en suspens. Par contre, chez certains groupes actuels de plantes à
fleurs, plusieurs études mettent en évidence qu’il existe une forte corrélation
entre un changement de pollinisateur et une diversification intense. C’est le
cas des plantes du genre Aquilegia,
comme décrit dans l’étude de Whittall et Hodges (2007) : l’interaction
très étroite avec des pollinisateurs spécialisés est fortement corrélée à
l’augmentation des taux de spéciation chez les plantes,
qui est la force évolutive à l’origine de l’apparition de nouvelles espèces.
Pour conclure, on peut dire que les plantes à fleurs sont probablement apparues suite à des remaniements intenses dans le génome, mais qu’elles ont pu se diversifier grâce à l’interaction avec les insectes pollinisateurs. On sait également que les insectes ne sont pas les seuls pollinisateurs des plantes à fleurs, et que dans de nombreux groupes tropicaux, ce sont les oiseaux et les chauves-souris qui assurent la pollinisation… Si les insectes n’avaient pas existé, il est probable qu’un autre groupe d’animaux auraient pris l’avantage et se seraient diversifié conjointement avec les angiospermes. Dire que les plantes à fleurs auraient pu se débrouiller toute seules, comme le fait M. Hallé, n’est donc pas entièrement juste et nécessite de considérer les phénomènes évolutifs avec le plus grand soin, afin de ne pas faire de raccourcis pour sauter d’une observation à la conclusion, sans passer par la case de la réflexion !
Bibliographie
Friedman, W.E. The meaning of Darwin’s
« abominable mystery ». 2009. American Journal of Botany. 96(1):5-21
Herendeen, P.S., Friss, E.M., Pedersen, K.R.,
Crane, P.R. 2017. Palaeobotanical redux: revisiting the age of the angiosperms.
3:17015
Grimaldi, D. The co-radiations of pollinating
insects and angiosperms in the Cretaceous. 1999. Annals of the Missouri
Botanical Garden. 86:373-406
Labandeira C.C. A paleobiologic perspective on
plant-insect interactions. 2013. Current opinion in Plant Biology. 16:414-421
Hu, S, Dilcher D.L., Jarzen D.M., Taylor D.W.
2008. Early steps of angiosperm–pollinator coevolution. PNAS.
105(1):240-245
De Bodt, S., Maere S., Van de
Peer, Y. 2005. Genome
duplication and the origin of angiosperms. Trends in Ecology and Evolution. 20(11):591-597
Whittall, J.B., Hodges, S.A. 2007. Pollinator
shifts drive increasingly long nectar spurs in columbine flowers.
447(7):706-710
Boris


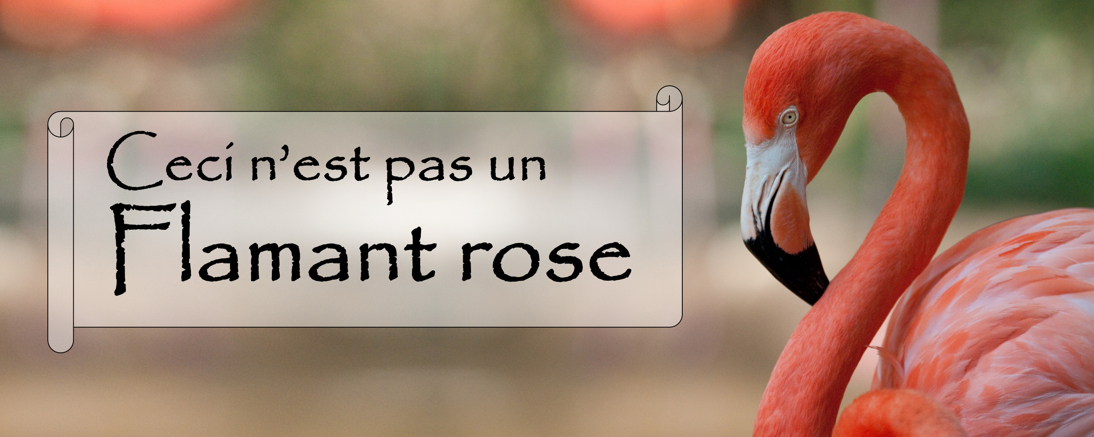




%2C%2BGreater%2BFlamingo%2B%2B(2).jpg)









