Il est 23h. La nuit noire est déchirée par des éclairs diffus, le tonnerre gronde au loin. Derrière mon volant, je ne peux réprimer un sourire : cinq ans après ma dernière visite, c’est la Camargue qui m’accueille, à sa façon !
L’aventure dans laquelle je m’embarque est bien différente de la dernière fois. S’il fallait être VIP pour participer au baguage des jeunes flamants, dont je vous contais le récit à l’époque, tout le monde est cette fois invité, et même encouragé, à participer à ces vacances améliorées et utiles que sont les chantiers bénévoles !
En Camargue, la SNPN (Société nationale de protection de la nature) organise chaque année des chantiers ouverts à ses adhérents au cours desquels les bénévoles s’attèlent à différents travaux. Le descriptif est succinct, mais difficile d’y résister : deux semaines au cœur de la réserve, des matinées de travail pour des après-midis de découvertes de la région à travers de multiples activités, un logement en gîte avec les autres bénévoles… tout ça pour une quarantaine d’euros d’adhésion et frais de dossier, trente pour les étudiants ! En termes de vacances utiles, on ne fait pas mieux. C’est donc sans savoir exactement à quoi m’attendre que je suis repartie sur ces terres déjà chargées de mes souvenirs de jeunesse.
Lundi matin, 8h30. J’arrive au gîte de Salin de Badon. Je découvre une grande bâtisse perdue en pleine campagne. Quelques bénévoles sont arrivés la veille, on sympathise rapidement. On sera une dizaine à vivre ici pour les deux prochaines semaines. Les encadrants arrivent également, des personnes qui travaillent sur place toute l’année. Le briefing nous met rapidement dans l’ambiance : décontractée ! Pas de chichis, on se tutoie, les blagues sont de rigueurs.
 |
| Le gîte de Salin de Badon, lieu de vie des bénévoles |
Le dur labeur des bénévoles
Le soleil tape déjà très fort – canicule oblige – quand nous partons sur le terrain. Au programme, pose de ganivelles le long des chemins de la réserve. Il s’agit de dissuader les promeneurs d’aller piétiner la flore si typique des milieux humides camarguais. La salicorne, c’est sacré ! Le travail est physique, on creuse des trous avec des gravières, on plante des piquets, on les encoche pour y poser des renforts, on déroule les ganivelles que l’on attache solidement au tout après leur avoir donné de bons coups de masse… La récompense après quelques heures : la plage, au bout du chemin ! A peine les outils posés, on s’y précipite tous de bon cœur. Je profite du chemin du retour pour enliser la voiture de la réserve dans le sable. Sinon on aurait pu s’ennuyer !
 |
| Ganivelles en cours de montage au cœur de la réserve, à quelques pas du phare de la Gacholle |
Si les ganivelles nous occupent une bonne partie du séjour, plusieurs matinées sont consacrées à d’autres travaux. Celui qui nous laissera le plus vif souvenir, c’est sans doute l’arrachage de la jussie. En dépit de son nom flatteur, référence au botaniste français Bernard de Jussieu, cette plante aquatique du genre Ludwigia est un fléau. Envahissante, elle se multiplie rapidement et jusqu’à envahir littéralement les zones aquatiques. Pour s’en débarrasser, il faut se jeter à l’eau. Munis de wadders (vous savez, ces grandes bottes qui montent jusque sous les bras et qui ont le don de vous dépouiller instantanément de toute grâce), appuyés sur une barque (même pas pour nous la barque ! c’est pour y mettre la jussie !), nous pénétrons dans la roubine. Qui n’a pas été dans une roubine ne peut pas comprendre… Il s’agit d’un petit canal, environ 2m de large, dont l’eau est pour ainsi dire stagnante. D’ailleurs, il n’est rempli qu’à 40% d’eau (partie haute), les 60% restant étant constitués de vase. Vase qui fait des bulles quand on marche dedans. Du moins quand on tente de marcher, car sitôt le pied posé, celui-ci est immédiatement capturé par la chose, emprisonné avec une force insoupçonnée. Force est d’avouer, au début, on panique ! Tout plantés que l’on est au milieu de la roubine, on voit déjà nos dernières heures arriver par une noyade inévitable dans une eau fétide. Ha oui, je n’ai pas précisé, les bulles qui sortent de la vase, ce ne sont pas des bulles de savon parfumées à la rose. Non, non. C’est autre chose. Tu mémorises le truc le plus puant que tu aies senti ? C’est pire. Bref, passé le cap de la panique et du dégoût, on y prend goût ! Hop on arrache des poignées de plantes, on te balance ça dans la barque, on se prend au passage des éclaboussures de vase (les racines sont profondes !), on en a plein les cheveux, plein le visage… Avantage n°1 : c’est finalement très drôle ! Avantage n°2 : quand on se prend l’averse du siècle sur la tête juste après être sortis de la roubine, on est contents d’être rincés !
 |
| L'impitoyable jussie ! (Crédits : Philweb) |
Dernier grand chantier auquel nous avons participé : la création d’un observatoire, une plateforme située le long de la route et depuis laquelle les curieux pourront observer la magnifique faune du plus vaste étang de Camargue : le Vaccarès. Avec ses 12 km de long et ses 6 500 hectares, il constitue un lieu incontournable pour nombre d’oiseaux, y compris les flamants roses. Un des grands avantages des chantiers bénévoles à mon sens réside dans la façon dont sont considérés les bénévoles. Si nous venons apporter nos petites mains, nous repartons aussi avec de l’expérience en plus. Les encadrants ont en effet à cœur de nous faire tester par nous même les outils, les techniques, même si ça veut parfois dire perdre un peu de temps. Un stage de bricolage pour débutants !
 |
| N'est-il pas magnifique notre observatoire ? Il manque encore la rampe d'accès et les barrières de sécurité et il sera parfait ! |
Après l’effort, le réconfort !
Pendant les chantiers, les bénévoles ne travaillent que le matin. Ce qui laisse pas mal de temps pour vaquer à d’autres occupations. Manger par exemple ! Le gîte est fourni, mais les bénévoles s’occupent de leur popotte. On s’organise comme en colonie : des menus prévus à l’avance, des courses pour tout le monde et un planning pour la semaine avec des commis de cuisine et de vaisselle pour chaque jour. Le temps de rentrer du terrain, de cuisiner et de manger, il est souvent 15h passé. Rebelotte pour le soir avec des diners aux alentours de 22h ! Horaires de vacances en somme. Il faut dire que s’il n’y avait pas un réveil le matin, on s’y croirait…
Plusieurs activités sont prévues par la SNPN, et offertes aux bénévoles. Au programme, une visite d’Arles et ses monuments accompagnés par une guide rien que pour nous, une balade à cheval version camarguaise (cheval camarguais, selle camarguaise, paysages camarguais au milieu de taureaux camarguais), la visite d’une expo naturaliste à la Capelière (le centre d’informations de la SNPN) et une sortie naturaliste pour observer les oiseaux. Sans compter les activités qu’on s’organise nous-même : marché à Arles, après-midi plage, joutes nautiques, courses camarguaises dans les arènes, et bien sûr des balades dans la réserve. Le gîte constitue le point de départ de trois sentiers naturalistes agrémentés d’observatoires, autant dire qu’il y a de quoi profiter ! Pour les mordus d’ornithologie comme pour les amoureux des petites bêtes, la Camargue c’est un peu le paradis. Je vous en donnerai un petit aperçu dans mon prochain article !
 |
| A cheval, nous voyons arriver le troupeau de taureaux. Pas peur ! |
 |
| Au bout d'un chemin accessible depuis notre gîte, un observatoire |
Les deux semaines sont trop vite écoulées, et il est déjà temps de repartir. Bronzés, musclés, les poumons remplis d’air frais, l’appareil photo bien garni et des souvenirs plein la tête, on se dit qu’on reviendrait bien l’année prochaine pour remettre ça !
Quelques prérequis indispensables si vous souhaitez vous lancer l’année prochaine :
- Il est préférable d’aimer la nature. Toute la nature. Y compris les moustiques, les taons, ou encore les chauves-souris dont le niveau sonore est inversement proportionnel à leur taille et qui ont élu domicile derrière les volets des chambres…
- Il faut savoir se satisfaire du nécessaire. Un peu d’eau fraiche… seulement si on n’a pas oublié de remplir les bidons avec de l’eau potable, à quelques kilomètres du gîte ! Internet, le réseau téléphonique et toutes ces autres futilités, c’est au petit bonheur la chance.
- Ne pas avoir peur de se salir. Et accepter de ne pas sentir la rose après la douche. L’eau courante vient de la roubine, celle-là même dont je parlais plus haut (en témoigne son odeur ! N’essayez pas de vous rincer la bouche avec après vous être lavé les dents ! Regrets immédiats…), mais l’odeur s’équilibre bien avec celle du savon en général.
- Aimer les gens. Eh bien oui, même si on est à des kilomètres de la ville la plus proche, il va bien falloir supporter les autres bénévoles. Y compris leurs ronchonnements au réveil, leur réticence à faire la vaisselle, leurs préférences alimentaires qui contraignent les menus, et leur humour qui varie à mesure que le soleil tape !
- Ne pas craindre les grands espaces. La Camargue, c’est immense, et très plat. Vision panoramique garantie à des kilomètres à la ronde, de quoi se sentir tout petit !
Les risques à accepter si vous décidez quand même de vous lancer :
- Gros risque d’émerveillement quant à la foisonnante biodiversité de la Camargue et ses paysages magnifiques. Sensation immédiate de liberté au milieu de ces espaces immenses. Des oiseaux et des insectes à n’en plus savoir donner de la tête. Retour difficile en perspective
- Changements physiques à prévoir : risque certain de revenir avec une surcharge musculaire et une légère coloration dorée de la peau (un conseil pour bien s’en rendre compte : prévoir de porter le même short plusieurs jours d’affilé les jours de grand beau temps. Effet jambes bicolores garanti !)
- Des fous-rires pour des broutilles (le soleil tape !), de la bonne humeur, des rencontres avec des personnes passionnées, du partage entre les bénévoles venus de tous horizons… Il y a le risque d’apprendre à cuisiner de l’houmous ou de la ratatouille, de découvrir des styles de musique dont tu ne soupçonnais pas l’existence, d’échanger des astuces et bons plans sur un tas de choses…
- L’envie irrépressible de remettre ça pour une nouvelle année !
Pour plus d’informations :
- Site web de la SNPN
- L’association produit également trois revues, dont Le Courrier de la Nature
- Suivez aussi la SNPN et la Réserve Naturelle Nationale de Camargue sur les réseaux sociaux : Twitter et Facebook





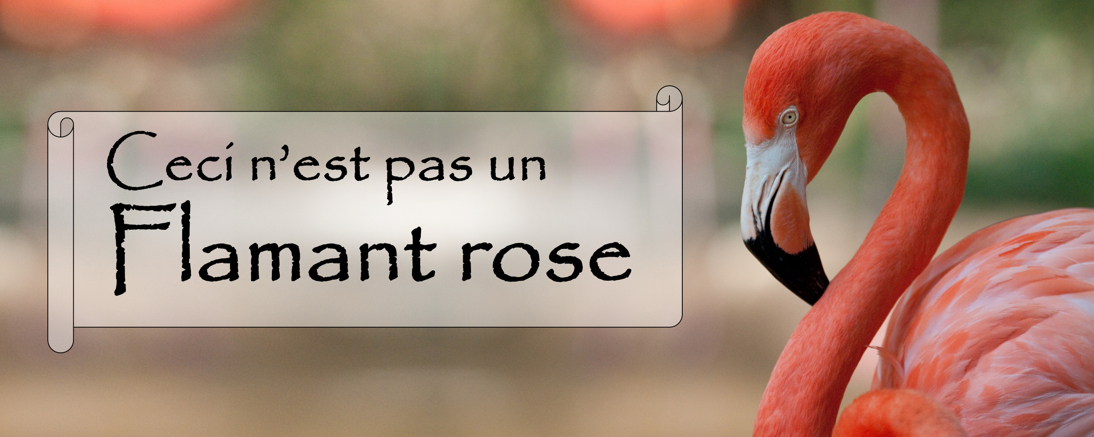




%2C%2BGreater%2BFlamingo%2B%2B(2).jpg)


















