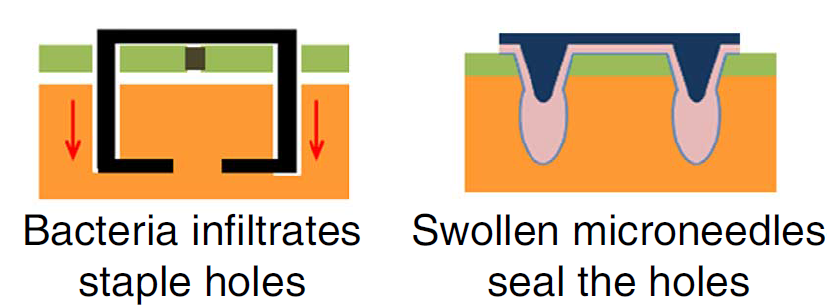Les bourdons font sans conteste partie des insectes les plus adorables : des petites boules de poils colorées toutes rondes et toutes gentilles, qui passent leur journées sur des jolies fleurs (non mais regardez moi ces petits derrières qui dépassent si ce n’est pas trop chou ! Et cette bouille !). En plus de ça, ils ont la bonne idée d’être très communs. Un régal de pouvoir les observer. D’ailleurs beaucoup de scientifiques s’en donnent aussi à cœur joie. Et ça donne aux blogueurs plein de choses à raconter ! Voici un petit florilège.
 |
| (Source) |
 |
| (Source) |
1. Le bourdon n’est pas une (unique) espèce
Au cas où il faille le préciser : non, les bourdons ne sont pas les mâles des abeilles. On surnomme même ces derniers des “faux-bourdons”, c’est dire. Abeilles et bourdons sont tout de même très proches puisqu’ils appartiennent à la même famille au sein de l’ordre des hyménoptères : les Apidae. Les bourdons sont ceux qui appartiennent au genre Bombus, et on en compte plus de 250 espèces. Bombus terrestris est le plus commun en Europe, et aussi un des plus étudiés. Les bourdons consomment le nectar des fleurs et utilisent également le pollen pour nourrir leurs jeunes. Ce sont donc d’importants pollinisateurs.
2. Ils se laissent des petits messages sur les fleurs
Lorsque les bourdons visitent des fleurs pour se nourrir, ils laissent derrière eux un marquage olfactif de courte durée[1, 2]. Les autres bourdons qui détectent un tel marquage sont avertis qu’un gourmand s’est déjà régalé sur la fleur, et qu’il ne reste peut-être plus grand chose à boulotter. D’ailleurs, les bourdons sont aussi capables de reconnaître l’odeur laissée par une abeille, et vice-versa, et ils évitent ainsi de perdre inutilement du temps sur une fleur qui ne vaut pas le coup. Des chercheurs ont même montré que lorsque les fleurs sont plus difficiles à butiner, les bourdons sont bien plus enclins à passer leur chemin quand ils sentent l’odeur d’un précédent visiteur que lorsqu’il s’agit de fleur simple d’accès[3] : pas bête la bête !
3. Ils sont sensibles à l’esthétisme
Les bourdons ont une préférence innée pour un certain type de fleurs : celles qui semblent plus complexes. C’est ce qu’on découvert des chercheurs qui ont proposé à des jeunes bourdons des fleurs dont la complexité avait été modifiée (chez les fleur, il existe une “échelle de complexité” qui prend en compte la forme, la symétrie, la segmentation des parties reproductives, etc.)[4]. Pourtant, ce sont ces fleurs qui demandent le plus d’efforts aux bourdon, en termes de temps de manipulation, ce qui conduit à une efficacité de butinage réduite[4]. Et comme les fleurs ont tout intérêt à ce que les bourdons s’attardent, une complexité florale serait donc bien utile pour garantir une bonne pollinisation ! Notons aussi qu’en termes de couleurs, ils préfèrent le jaune et le bleu plutôt que du rouge[5].
 |
| Fleur dont les pétales ont été arrangés par les scientifique pour apparaître plus complexe (à gauche) ou plus simple (à droite)[4] |
4. Ils contrôlent le climat en jouant les ventilateurs...
Pour contrôler la température du couvain (œufs et larves), les bourdons ventilent. Chez Bombus terrestris, une espèce sociale, la division du travail est de mise. Les travailleurs habitués à jouer les ventilateurs ont des meilleures performances dans cette tâche, et réagissent plus promptement à une augmentation de la température du nid que les novices[6]. Le comportement ventilatoire dépend aussi de la vitesse à laquelle la température augmente : les bourdons sont plus réactifs à une augmentation progressive de la température qu’à un changement brutal[6]. Ils sont également capables de détecter une augmentation de la concentration en CO2 dans le nid, et de réagir en conséquence[7] !
5. … et peuvent également modifier leur propre température corporelle !
Pour parvenir à s’envoler, les bourdons, comme beaucoup d’insectes, ont besoin que leur corps atteigne une certaine température, située autour de 30°C. Les bourdons sont cependant capables de voler alors que la température extérieure n’atteint pas 10°C. Pour réchauffer leurs corps avant l’envol, ils… frissonnent vigoureusement[8] ! Le comportement est visible : les animaux pompent l’air avec leur abdomen pour ventiler les muscles du vol, ceux-là même réquisitionnés pour frissonner. Plus il fait froid, plus ils doivent frissonner longtemps pour pouvoir s’envoler : de quelques secondes au dessus de 20°C à un quart d’heure à moins de 10°C[9].
6. Ils s’occupent de leurs morts
Bon, il n’y a clairement pas de cérémonie religieuse. C’est plutôt pragmatique. Dans une société où les individus se côtoient étroitement, laisser un cadavre entrer en décomposition représente un risque sanitaire certain. Ce n’est donc pas étonnant que fourmis et abeilles, dont les colonies peuvent compter des milliers d’individus, réagissent promptement au décès d’un des membres en l’éliminant fissa. C’est aussi le cas chez les bourdons, tout du moins chez l’espèce Bombus terrestris qui est sociale[10]. Les cadavres de larves sont ainsi largement éliminés par des bourdons ouvriers spécialisés, plus gros que la moyenne. Les cadavres d’adultes sont également retirés, cependant moins souvent que les larves. A noter que les animaux malades, qui présentent donc un risque sanitaire pour la colonie, ne semblent pas se faire exclure[10]. A voir si c’est le cas pour tous les pathogènes.
7. Ils peuvent apprendre à leurs congénères… à jouer à la balle !
Quitte à étudier les capacités cognitives des insectes, autant le faire de la manière la plus fun possible ! Des chercheurs ont ainsi appris à des bourdons à déplacer une petite balle jusqu’à un endroit spécifique, en échange d’une récompense sucrée[11]. En dépit de la difficulté à manier l’objet pour de si petits animaux, les bourdons ont été capables de reproduire le geste que leur ont montré les chercheurs par l’intermédiaire d’un faux bourdon. Mieux encore, l’apprentissage par observation marche avec les congénères : ceux qui ont appris à jouer deviennent ainsi les entraîneurs des nouveaux joueurs. Non seulement ces derniers assimilent la tâche à faire pour avoir la récompense, mais ils développent aussi leurs propres techniques de dribble pour amener la balle à l’endroit voulu !
8. Certains pratiquent la tactique du coucou
Chez quelques espèces comme Bombus vestalis ou Bombus bohemicus, le réveil printanier se fait tranquillement, quelques semaines après les autres bourdons. Un délai qui laisse le temps à ces derniers d’établir leurs colonies, et permet aux bourdons tardifs de mettre en place leur stratégie : le parasitisme social[12]. Les femelles fraîchement réveillées se mettent ainsi à la recherche des colonies de leurs hôtes, dont elles prennent ensuite le contrôle en assassinant la reine… Après ce coup d’état, elles commencent à pondre des œufs. Les bourdons ouvriers de la colonie parasitée en deviendront les nounous et s’en occuperont comme si c’était des jeunes de leur propre colonie. Cette pratique peut paraître cruelle mais les femelles des espèces parasites ont une excuse toute trouvée : elles ne disposent pas de paniers à pollen pour récolter ce dernier, indispensable à l’élevage des jeunes. Pas le choix…
9. Ils se font manipuler par des mouches
D’autres groupes d’insectes se plaisent à parasiter les bourdons, et à les contrôler. C’est notamment le cas de Physocephala tibialis. Cette petite mouche pond ses œufs dans le corps des bourdons. La larve se développe ensuite dans le corps du pauvre animal qui finit par en mourir, puis se transforme en pupe (le stade de développement entre la larve et l’adulte) et passe l’hiver ainsi, bien au chaud dans son hôte. Le refuge est encore plus sûre si le cadavre est caché et à l’abris des conditions météorologique. Qu’à cela ne tienne, le parasitoïde (c’est ainsi que l’on appelle les parasites qui se développent dans un hôte en le tuant au passage…) est un manipulateur ! Il induit une modification du comportement de son hôte : avant de mourir, le bourdon va lui-même creuser sa propre tombe et s’y enterrer[13]…
 |
| Physocephala tibialis, la terrible manipulatrice de bourdons (Source) |
10. On en connait un vieux de 30 millions d’années
Une petite note plus joyeuse pour finir : je vous présente Calyptapis florissantensis, un bourdon fossilisé[14] ! Bon, il ne fait pas partie des Bombus, on lui a spécialement créé son propre genre. Il a été trouvé au Colorado (Etats-Unis), sur un site très réputé pour ses fossiles conservés grâce à la forte activité volcanique qui y régnait à la fin de l’Eocène, il y a plus de 30 millions d’années ! Plus de 1500 espèces d’invertébrés fossiles ont ainsi été dénombrées, sans compter les autres animaux et plantes préhistoriques.
 |
| Calyptapis florissantensis, un bourdon fossilisé de plus de 30 millions d’années |
Références
- Stout JD & Goulson D. 2001. The use of conspecific and interspecific scent marks by foraging bumblebees and honeybees. Animal Behaviour, 61, 183-189.
- Goulson D, Ahawson S & Stout JD. 1998. Foraging bumblebees avoid flowers already visited by conspecifics or by other bumblebee species. Animal Behaviour, 55, 199-206.
- Saleh N, Ohashi K, Thomson JD & Chittka L. 2006. Facultative use of the repellent scent mark in foraging bumblebees: complex versus simple flowers. Animal Behaviour, 71, 847-854.
- Krishna S & Keasar T. 2019. Bumblebees forage on flowers of increasingly complex morphologies despite low success. Animal Behaviour, 155, 119-130.
- Simonds V & Plowright CMS. 2004. How do bumblebees first find flowers? Unlearned approach responses and habituation. Animal Behaviour, 67, 379-386.
- Westhus C, Kleineidam CJ, Roces F & Weidenmüller A. 2013. Behavioural plasticity in the fanning response of bumblebee workers: impact of experience and rate of temperature change. Animal Behaviour, 85, 27-34.
- Weidenmüller A, Kleineidam C & Tautz J. 2002. Collective control of nest climate parameters in bumblebee colonies. Animal Behaviour, 63, 1065-1071.
- Heinrich B & Kammer AE. 1973. Activation of the fibrillar muscles in the bumblebee during warm-up, stabilization of thoracic temperature and flight. Journal of Experimental Biology, 58, 677-688.
- www.bumblebee.org
- Munday Z & Brown MJF. 2018. Bring out your dead: quantifying corpse removal in Bombus terrestris, an annual eusocial insect. Animal Behaviour, 138, 51-57.
- Loukola OJ, Perry CJ, Coscos L & Chittka L. 2017. Bumblebees show cognitive flexibility by improving on an observed complex behavior. Science, 355, 833-836.
- Kreuter K, Twele R, Francke W & Ayasse M. 2010. Specialist Bombus vestalis and generalist Bombus bohemicus use different odour cues to find their host Bombus terrestris. Animal Behaviour, 80, 297-302.
- Müller CB. 1994. Parasitoid induced digging behaviour in bumblebee workers. Animal Behaviour, 48, 961-966.
- Cockerell TDA. 1906. Fossil Hymenoptera from Florissant, Colorado. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, 50, 33-58.