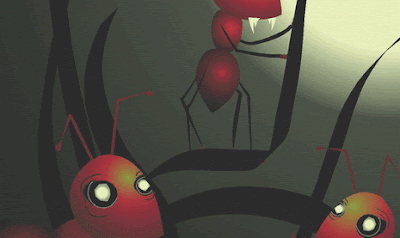...Ou le monde fabuleux des parasites manipulateurs
Si la fête d’Halloween nous a amené sa ribambelle de monstres en tous genres, je vous propose aujourd’hui de rester dans le thème et parler des zombies. Attention, pas ces zombies snobs qui se pavanent dans des films grotesques comme « Shaun of the Dead » ou « Warm bodies »… Ces humains complètement gaga et tout baveux se croient célèbres sous prétexte qu’ils apparaissent dans une poignée de longs métrages (quelques 350 selon
Wikipédia, pas de quoi en faire toute une histoire…), alors qu’au fond, à part terroriser les foules, ils ne servent pas à grand chose. Un bon zombie est un zombie utile ! C’est un zombie prêt à tout pour servir son créateur, y compris se jeter littéralement dans la gueule du loup.
Qui a besoin des zombies ?
En tant qu’être humain, il faut avouer qu’un zombie a une utilité relativement limitée. Des personnes pour faire le travail à notre place, on en a déjà. Nos gosses, nos employés, nos chiens s’ils sont bien dressés… Et puis la technologie fait des miracles, les ordinateurs et robots s’occupent de presque tout à l’heure actuelle, sans même qu’on s’en aperçoive. Mais il existe des créatures qui ont un besoin crucial d’un autre individu pour les maintenir en vie. Je ne suis pas en train de parler de Voldemort qui squatte le crâne de ce pauvre
professeur Quirrell, mais finalement l’exemple se rapproche pas mal de la réalité. Si vous n’avez pas compris ma dernière phrase (mais vous vivez où ?!), brève explication. Voldemort (l’ennemi de Harry Potter, le mec qui vit sous un escalier), est un sorcier anéanti, incapable de se fabriquer un corps comme tout un chacun avec ce qu’il faut pour se déplacer, trouver de la nourriture, communiquer, etc. (bon, par la suite il reprendra du poil de la bête). Pour survivre, il habite littéralement le corps d’un hôte humain, et non seulement il puise en lui les ressources nécessaires pour survivre, mais en plus il le mène à la baguette (de sorcier !) pour lui faire faire ce qu’il veut (tenter de tuer des mômes par exemple). Hé bien finalement, c’est exactement ce que font nos créatures zombifiantes du jour : les
parasites manipulateurs.
Les parasites sont des créatures qui vivent aux dépens d’autres êtres vivants (les
hôtes). Les parasites les plus intéressants (et je ne dis pas ça parce qu’ils constituent le sujet de ma thèse), sont les parasites dit «
hétéroxènes », c'est-à-dire qu’ils ont besoin de plusieurs hôtes successifs pour boucler leur cycle de vie (naitre, grandir, se reproduire). Par exemple, la
très célèbre petite douve du foie
Dicrocoelium dendriticum va vivre une partie de sa vie dans des escargots, puis va passer chez des fourmis via la bave du gastéropode, et finir son cycle dans des mammifères herbivores, comme des vaches ou des moutons.
 |
| Cycle de vie de la petite douve du foie (Source) |
 |
| La photo de notre très sexy petite douve... (Source) |
Quel est le rapport entre les parasites et les zombies ? Hé bien, prenons notre petite douve du foie, qui est minuscule et qui ne sait même pas marcher. Pauvre petit être sans défense, comment ferait-elle toute seule, perdue dans la nature immense et hostile, pour repérer son mouton, lui sauter dessus et forcer l’intrusion dans son organisme ? Mission impossible. La douve utilise une méthode bien plus subtile… La fourmi possède des pattes, elle. Et puis elle pourrait s’approcher des moutons en grimpant en haut des brins d’herbes… La douve, comme beaucoup de parasites, est devenue l’illustration même de la célèbre maxime « on n’est jamais mieux servi que par quelqu’un d’autre ». Et la pauvre fourmi, zombifiée, dirigée par son impitoyable tortionnaire, va bravement aller se faire dévorer par des moutons…
Les grandes stars
Les parasites qui « dictent » à leur hôte de se faire dévorer par le prochain hôte, on en trouve à foison dans la nature. L’exemple de la douve est
très connu. Parmi les grandes célébrités, nous avons aussi
Leucochloridium paradoxum. Ce ver plathelminthes, qui habite d’abord dans un escargot, doit finir son cycle dans un oiseau. Ces derniers, bien que prédateurs, ont malheureusement une préférence pour des chenilles. Qu’à cela ne tienne, le ver va induire une transformation des yeux de l’escargot en une réplique quasi parfaite de la nourriture favorite de l’oiseau ! Et pour plus d’efficacité, l’escargot attendra sagement bien en évidence en pleine lumière qu’un oiseau vienne lui picorer les yeux.
Jetez un œil ici pour plus de détails et explications sur le lugubre calvaire du pauvre gastéropode.
En continuant dans la lignée des grandes stars de la manipulation, vous avez peut être déjà croisé ces images de fourmis au derrière si rouge et si gonflé qu’il ressemble à s’y méprendre à une baie, très alléchante pour les oiseaux… La faute au nématode Myrmeconema neotropicum, qui, comme vous l’aurez deviné, finit également son cycle chez un oiseau.
 |
| L'abdomen de ces fourmis, noir à l'origine, se teinte de rouge et se détache 14 fois plus facilement du reste du corps quand l'animal est parasité (Sources ici et là) |
Plus de subtilité pour une perfide efficacité
Pour beaucoup de mes lecteurs, les exemples que je viens de citer ne sont pas une nouveauté. Scientifiques comme grand public apprécient la magie des lugubres transformations de ces zombies, digne de films de science fiction. Mais ces extravagances détournent l’attention des œuvres de la grande majorité des parasites manipulateurs, beaucoup plus subtiles dans leurs procédés. Sans compter qu’un hôte intermédiaire (le zombie) ne sert pas uniquement de véhicule vers l’hôte final : il a des ressources à exploiter.
Petit descriptif des caractéristiques et panel d’options à disposition des parasites, logés bien au chaud dans leur hôte. Voici, pour illustrer, une brochure publicitaire trouvée chez un concessionnaire d’hôtes intermédiaires à l’usage des parasites acanthocéphales et trématodes :
« Tenez-vous bien, on a ici le nec plus ultra. Au sein de votre zombie, moelleux et de tout confort, vous pourrez vous développer à votre rythme sans difficulté, puisant dans votre hôte toutes les ressources dont vous aurez besoin [1]. Les zombies de luxe sont pourvus d’options pour moduler la quantité et qualité de ressources disponibles [2-3]. Votre zombie vous baladera tranquillement au gré de ses mouvements, vers une destination que vous pourrez choisir vous-même [4], jusqu’à ce que vous soyez prêts à vous en séparer. Vous pouvez activer l’option « protection anti-prédateur » [5-6-7], qui vous assurera une plus grande sécurité durant votre développement, réduisant la probabilité que votre zombie (et vous avec) se fasse dévorer. Une fois au dernier stade de votre développement avant votre prochain hôte, vous pourrez activer l’option « se faire volontairement bouffer » pour atterrir sans le moindre effort directement à l’intérieur même de votre hôte suivant [8-9-10-11]. Je vous conseille de choisir, lors de l’activation de cette option, des paramètres adaptés à votre future hôte, histoire de ne pas se faire dévorer par la mauvaise espèce [4-12]. »
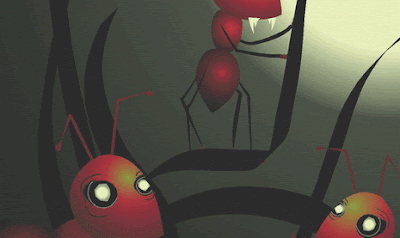 |
| Des fourmis, contrôlées par des parasites, deviennent des véhicules de luxe tout-équipés (Source) |
L’exemple des gammares et des acanthocéphales
Cette description est bien jolie mais on se demande toujours quels sont les traits concrètement modifiés chez les hôtes zombifiés. Pour illustrer ça, je vais prendre un des exemples préférés des chercheurs qui bossent sur la manipulation parasitaire, et qui accessoirement constitue le cœur de mon sujet de thèse : les gammares, parasités par des acanthocéphales.
Les gammares sont des petits crustacés très abondants dans nos rivières, avec de nombreuses espèces présentes en Europe. Ils constituent le repas de nombreux prédateurs : oiseaux, amphibiens, créatures vertébrées qui peuplent nos rivières (ouais, ce qu’on appelle vulgairement « poissons » quoi)… Et ils sont également l’hôte intermédiaire de nombreux parasites, dont plusieurs espèces du groupe des acanthocéphales. En général, les acanthocéphales ont pour hôte final un poisson ou un oiseau selon les espèces. Ils se reproduisent dans le tube digestif de ces hôtes, et pondent des œufs qui seront libérés dans le milieu avec les fèces de l’animal. Les gammares vont à leur insu consommer ces œufs, et permettre au parasite de se développer. Celui-ci passera par deux stades distincts. Seul le deuxième est viable pour être transmis à l’hôte final. L’intérêt pour le parasite est donc de grandir tranquillement dans le gammare jusqu’à atteindre ce deuxième stade, puis de laisser son hôte gammare se faire dévorer par un oiseau ou un poisson pour retrouver le lieu propice à la reproduction, et boucler le cycle.
 |
| Le parasite acanthocéphale (genre Polymorphus) est ici très clairement visible à travers la cuticule de ce gammare Gammarus lacustris (Source) |
 |
| Cycle de vie d'un acanthocéphale ayant pour hôte final un poisson et pour hôte intermédiaire un gammare |
Premier constat des chercheurs : les gammares qui abritent des parasites sont plus enclins à se faire dévorer par les prédateurs [10-9]. Des dizaines d’études se sont alors penchées sur le sujet : qu’est-ce qui change entre un gammare sain et un gammare parasité qui mènerait à cette différence de prédation ? Petit listing non exhaustif.
Tout d’abord, la couleur du gammare change, puisque les acanthocéphales, d’une couleur allant du jaune au rouge, sont visibles par transparence [13-14]. Mais plus que l’apparence, ce sont les changements de comportements qui intriguent. Les gammares, vivant d’ordinaire dans le fond des rivières et dans des endroits sombres et abrités, sont subitement attirés par la lumière [15-16], se mettent à nager en surface [17-18] et dédaignent les refuges [9-10]. Le tout en s’agitant bien plus qu’à l’ordinaire [16]. En somme, ils deviennent très faciles à repérer par les prédateurs. Et puis plutôt que d’aller se fondre dans la masse de leurs congénères pour passer incognito, ils se la jouent subitement solitaire [19-20]. La manipulation va pourtant bien plus loin que ça : non content d’être bien repérables, les gammares parasités vont développer une affinité avec… leur prédateur lui-même. Si leurs congénères sains (d’esprit…) vont rapidement se mettre à couvert quand ils détectent une odeur de prédateurs, nos gammares parasités vont y être irrémédiablement attirés… [8-9-10]
Pour pousser la subtilité encore plus loin, rappelez-vous que les parasites ont un intérêt à ce que leur hôte gammare se fasse dévorer seulement quand ils ont eux-mêmes atteint leur deuxième stade de développement. Hé bien tant qu’ils sont au premier stade, la manipulation va quand même s’observer mais… dans l’autre sens ! Pour faire simple, le parasite va modifier le comportement du gammare d’une manière menant à une réduction de ses chances qu’il se fasse croquer par un prédateur. Les gammares vont par exemple passer plus de temps à l’abri [6]. Et puis il y a aussi l’histoire du mauvais prédateur : c’est bien beau d’être repérable, mais si le gammare se fait manger par un poisson alors que le parasite doit se développer dans un oiseau, ça ne sert pas à grand-chose… Hé bien même à ce niveau-là le parasite semble avoir trouvé la parade. Par exemple, des variations temporelles peuvent être observées : les gammares seraient ainsi attirés vers la surface seulement la nuit, ou le jour, menant respectivement à une prédation par des animaux nocturnes ou diurnes [4]. Sans compter que les comportements modifiés sont différents selon l’hôte final visé, menant effectivement à une prédation plus importante par le « bon » hôte [10].
 |
| Au premier stade de leur développement, les acanthocéphales rendent leurs hôtes gammares plus résistants à la prédation (Source) |
Adaptation ou effet secondaire ?
Par soucis de vulgarisation, j’ai présenté l’effet des parasites sur leurs hôtes de manière très déterministe et finaliste. Cependant, à l’heure actuelle et malgré des dizaines d’années d’études sur les parasites manipulateurs, la question se pose toujours (et peut être même plus encore) sur le caractère adaptatif de ces modifications [21]. Est-ce que les comportements des hôtes parasités ont vraiment évolué parce qu’ils apportaient un bénéfice au parasite ? Ou est-ce que ces modifications ne sont que des effets secondaires induits par l’infection, pas forcément bénéfique pour le parasite, ni même pour l’hôte ?
La question n’a pas de réponse précise à l’heure actuelle, mais il semble que les deux hypothèses soient valables selon le trait qu’on considère. Certaines études ont par exemple montré que le changement d’apparence de nos gammares n’avait pas d’effet sur ses chances d’être prédaté [14], de quoi tordre le cou à l’explication adaptative. De même, les comportements d’ordre global (modification de l’activité générale de nos animaux par exemple) pourraient n’être qu’une conséquence physiologique de l’infection, détectable quelque soit le parasite (y compris ceux qui ont un cycle de vie simple). En revanche, la spécificité de certaines modifications de comportement donne des points à l’explication adaptative. Par exemple, le comportement d’un gammare sera modifié différemment selon qu’il est parasité par une espèce qui veut terminer sa vie dans un oiseau, ou dans un poisson, et cette différence va effectivement mener à un risque de prédation plus grand, respectivement par des oiseaux ou des poissons [10]. De plus, la manipulation inversée au cours du premier stade du développement du parasite soutient également une évolution liée aux bénéfices pour le parasite à modifier le comportement de l’hôte. Toujours est-il que la question reste entièrement ouverte, les parasites affectant en général simultanément de nombreux traits de l’hôte, les deux explications pouvant être également simultanément tout à fait plausibles.
Faut-il craindre les parasites manipulateurs ?
En dépits de leurs pratiques qui peuvent paraître lugubres, les parasites manipulateurs sont connus pour jouer un rôle important dans les écosystèmes [22], du fait notamment de leur capacité à modifier les relations biotiques. Cependant, quand ces relations biotiques font intervenir l’homme, c’est une autre histoire.
La malaria, ou paludisme, est une maladie due à un parasite unicellulaire du genre Plasmodium, et qui causerait chez l’humain près d’un million de morts par an. Vous imaginez alors l’intérêt de comprendre tout le cycle de ce parasite, en termes d’applications préventives par exemple. Ce parasite est transmis à l’homme via le moustique. Et si ces derniers sont souvent largement blâmés pour être le vecteur de cette terrible maladie, ils n’y sont relativement pour rien. Et même pire : le parasite va pousser le moustique à nous contaminer… Des études ont ainsi montré que le parasite vampirise encore plus les moustiques, qui non seulement vont se mettre à piquer bien plus de gens, mais en plus vont être du genre collant, se nourrissant plus longtemps sur chaque victime [23]. Le parasite bénéficie donc à la fois d’un plus grand nombre d’hôtes potentiels, et aussi de plus de temps pour opérer le changement d’hôte… Ce caractère manipulateur du parasite est malheureusement encore trop ignoré dans les modèles épidémiologiques.
 |
| Le moustique, vecteur du parasite de la malaria, voit son comportement de nourrissage modifié sous l'emprise de ce parasite, augmentant sa probabilité de transmission (Source) |
Deuxième exemple avec un autre protozoaire, le parasite
Toxoplasma gondii, qui est responsable chez l’humain de la toxoplasmose. Le cycle classique de ce parasite comprend un hôte intermédiaire, souvent le rat, et un hôte final, le chat, au sein duquel il se reproduit. Comme vous l’aurez deviné, un rat infecté va présenter des
modifications comportementales augmentant sa probabilité de se faire croquer par le matou du coin…
[24] En d’autres termes, nos rongeurs infectés vont soudainement être attirés par leur ennemi mortel ! Si vous vous étonnez que votre chat d’ordinaire paresseux et incapable vous ramène une belle proie, prenez garde… Même si l’humain ne fait pas partie du cycle classique du parasite, il peut tout à fait être infecté. Si contrairement à une idée reçue, la transmission ne se fait pas par simple contact avec votre animal, une ingestion impromptue de fèces (vous vous touchez le visage après avoir changé la litière du chat…) est vite arrivée (si, si !). Et même si les humains sont une voie sans issue pour le parasite, les patients affectés présentent une personnalité et un niveau de QI altérés…
[25] Quand aux parasites responsables de la malaria, ils auraient également un effet sur nous, rendant les humains plus alléchants pour les moustiques...
[26] Considérant le nombre important de parasites en tous genres capables de nous infecter, on a de quoi se poser des questions… Sommes-nous en permanence sous l’emprise d’une maléfique manipulation ? Sommes-nous finalement déjà tous des zombies ?...
 |
| Des souris qui aiment les chats, ça existent. Elles ne sont pas forcément masos, mais probablement sous l'emprise d'un parasite tel que celui de la toxoplasmose qui les pousse à aller se faire dévorer (Source) |
Bibliographie :
- [1] Benesh, D. P. & Valtonen, E. T. 2007. Effects of Acanthocephalus lucii (Acanthocephala) on intermediate host survival and growth: implications for exploitation strategies. Journal of parasitology, 93, 735–741.
- [2] Gaillard, M., Juillet, C., Cézilly, F. & Perrot-Minnot, M.-J. 2004. Carotenoids of two freshwater amphipod species (Gammarus pulex and G. roeseli) and their common acanthocephalan parasite Polymorphus minutus. Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 139, 129–136.
- [3] Minchella, D.J., Leathers, B.K., Brown, K.M. & McMair, J.N. 1985. Host and parasite counteradaptations: an example from a fresh-water snail. American Naturalist, 126, 843–854.
- [4] Lagrue, C., Kaldonski, N., Perrot-Minnot, M.J., Motreuil, S. & Bollache, L. 2007. Modification of hosts’ behavior by a parasite: field evidence for adaptive manipulation. Ecology, 88, 2839–2847.
- [5] Hammerschmidt, K., Koch, Milinski, K.M., Chubb, J.C. & Parker, G.A. 2009. When to go: optimization of host switching in parasites with complex life cycles. Evolution, 63, 1976–1986.
- [6] Dianne, L., Perrot-Minnot, M.-J., Bauer, A., Gaillard, M., Léger, E., Rigaud, T. & Elsa, L. 2011. Protection first then facilitation: a manipulative parasite modulates the vulnerability to predation of its intermediate host according to its own developmental stage. Evolution, 65, 2692–2698.
- [7] Médoc, V. & Beisel, J.-N. 2011. When trophically-transmitted parasites combine predation enhancement with predation suppression to optimize their transmission. Oikos, 120, 1452–1458.
- [8] Baldauf, S.A., Thünken, T., Frommen, J.G., Bakker, T.C.M., Heupzl, O. & Kullmann, H. 2007. Infection with an acanthocephalan manipulates an amphipod’s reaction to a fish predator’s odours. International Journal for Parasitology, 37, 61-65.
- [9] Perrot-Minnot, M.-J., Kaldonski, N. & Cézilly, F. 2007. Increased susceptibility to predation and altered anti-predator behaviour in an acanthocephalan-infected amphipod. International journal for parasitology, 37, 645–51.
- [10] Kaldonski, N., Perrot-Minnot, M.-J. & Cézilly, F. 2007. Differential influence of two acanthocephalan parasites on the antipredator behaviour of their common intermediate host. Animal Behaviour, 74, 1311–1317.
- [11] Carney, W.P. 1969. Behavioral and morphological changes in carpenter ants harboring dicrocoeliid metacercariae. The American Midland Naturalist Journal, 82, 605–611.
- [12] Webber, R.A., Rau, M.E. & Lewis, D.J. 1987. The effects of Plagiorchis noblei (Trematoda: Plagiorchiidae) metacercariae on the susceptibility of Aedes aegypti larvae to predation by guppies Poecilia reticulata and meadow voles (Microtus pennsylvanicus). Canadian Journal of Zoology, 65, 2346–2348.
- [13] Bakker, T. C. M., Mazzi, D., & Zala, S. 1997. Parasite-induced changes in behavior and color make Gammarus pulex more prone to fish predation. Ecology, 78, 1098–1104.
- [14] Kaldonski, N., Perrot-Minnot, M.-J., Dodet, R., Martinaud, G. & Cézilly, F. 2009. Carotenoid-based colour of acanthocephalan cystacanths plays no role in host manipulation. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society, 276, 169–76.
- [15] Bauer, A., Trouvé, S., Grégoire, A., Bollache, L. & Cézilly, F. 2000. Differential influence of Pomphorhynchus laevis (Acanthocephala) on the behaviour of native and invader gammarid species. International journal for parasitology, 30, 1453–7.
- [16] Maynard, B.J., Wellnitz, T.A., Zanini, N., Wright, W.G., Dezfuli, B.S. 1998. Parasite-altered behaviour in a crustacean intermediate host: field and laboratory studies. Journal of Parasitology, 84, 11062-1106.
- [17] Haine, E. R., Boucansaud, K. & Rigaud, T. 2005 Conflict between parasites with different transmission strategies infecting an amphipod host. Proceedings of the Royal Society B, 272, 2505–2510.
- [18] Bauer, A., Haine, E.R., Perrot-Minnot, M.J. & Rigaud, T. 2005. The acanthocephalan parasite Polymorphus minutus alters the geotactic and clinging behaviours of two sympatric amphipod hosts: the native Gammarus pulex and the invasive Gammarus roeseli. Journal of Zoology, 267, 39–43.
- [19] Durieux, R., Rigaud, T., & Médoc, V. 2012. Parasite-induced suppression of aggregation under predation risk in a freshwater amphipod. Behavioural Processes, 91, 207–213.
- [20] Lewis, S. E., Hodel, A., Sturdy, T., Todd, R. & Weigl, C. 2012. Impact of acanthocephalan parasites on aggregation behavior of amphipods (Gammarus pseudolimnaeus). Behavioural processes, 91, 159–63.
- [21] Thomas, F., Adamo, S. & Moore, J. 2005. Parasitic manipulation: where are we and where should we go? Behavioural processes, 68, 185–99.
- [22] Lefèvre, T., Lebarbenchon, C., Gauthier-Clerc, M., Missé, D., Poulin, R. & Thomas, F. 2009. The ecological significance of manipulative parasites. Trends in ecology & evolution, 24, 41–48.
- [23] Koella, J.C., Sørensen, F.L. & Anderson, R.A. 1998. The malaria parasite, Plasmodium falciparum, increases the frequency of multiple feeding of its mosquito vector, Anopheles gambiae. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society, 265, 763–8.
- [24] Berdoy, M., Webster, J. P. & Macdonald, D. W. 2000. Fatal attraction in rats infected with Toxoplasma gondii. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society, 267, 1591–1594.
- [25] Flegr, J. & Hrdy, I. 1994 Influence of chronic toxoplasmosis on some human personality factors. Folia Parasitologica, 41, 122-126.
- [26] Lacroix, R., Mukabana, W.R., Gouagna, L.C. & Koella, J.C. 2005. Malaria infection increases attractiveness of humans to mosquitoes. PLoS Biology, 3, 1590–1593.
Note : la bibliographie, donnée à titre d'exemple, est très loin de l'exhaustivité, la littérature dans le domaine étant innombrable.
Sophie Labaude