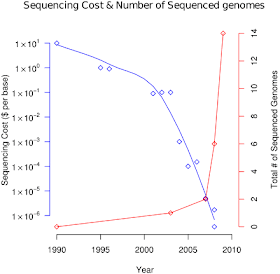C’est un peu une
super période pour les animaux « non bilatériens » en ce moment (les
animaux qui ne sont pas divisés en seulement deux côtés symétriques). Entre
l’incroyable découverte d’un nouvel organisme dont je vous ai parlé récemment (un nouveau casse-tête pour les zoologistes),
des recherches récentes sur les cténaires (de notre relation avec Bob l'Eponge) et mon article sur le mouvement des éponges posté il y a moins d’un an (Essuyons quelques préjugés sur les éponges),
ce sont les informes et délaissés placozoaires qui vont nous intéresser aujourd’hui. Un
article intéressant sur le sujet est paru il y a quelques mois. Pourtant les
placozoaires sont probablement les animaux à l’apparence la plus simple. En
plus c’est un groupe un peu triste, ne comprenant qu’une seule espèce décrite :
Trichoplax adherens. Leur génome a
été séquencé et montre une complexité bien supérieure à leur anatomie.
Cependant, une étude parue en juillet dernier montre que pas moins d’un tiers
de la morphologie de cet animal était encore inexplorée. Laissez-moi vous
raconter l’histoire du pauvre placozoaire.
 |
Le pauvre et informe placozoaire… Et en plus il ne
mesure que quelques millimètres (souvent entre un et trois). (Source : il faut toujours utiliser wiki)
|
Aujourd’hui nous
sommes dans l’ère de la génomique (faut bien faire de grandes généralités).
Séquencer un génome coûte de moins en moins cher et est de plus en plus facile.
On est techniquement loin du temps où il fallait plusieurs laboratoires et
plusieurs années pour séquencer un génome (voir sur tout se passe comme si). Et si le génome de tous les
« organismes modèles » en biologie a été séquencé, le séquençage
des génomes est même pratiqué maintenant pour des organismes plus obscurs, comme
montré dernièrement dans plusieurs articles sur les cténophores parus dans Science
et Nature et dont l’un d’eux a été très bien commenté par Taupo (ici, encore).
L’initiative est louable, et nous sommes tous impatients de voir le moment où
la plupart des génomes seront disponibles. Aussi, c’est en 2008, il y a six ans
déjà, que le génome de l’étrange et discret placozoaire était séquencé. Mais
qu’est-ce qu’un placozoaire ?
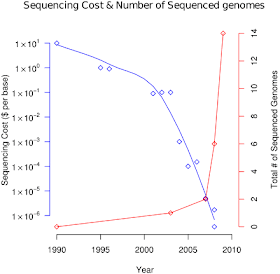 |
Evolution du coût de séquençage d’un génome et du
nombre de génomes séquencés en fonction du temps. Ouaip, ça va vite ! (Source : la courbe qui fait sérieux)
|
Les placozoaires,
déjà évoqués ici (Evolution et complexité, ce n'est pas si simple), sont juste des petits matelas de
quelques cellules, rampant au fond des eaux marines côtières. Ce sont des
animaux uniques, différents de ceux dont qu’on est habitués à voir. L’origine
de ce groupe remonte probablement aux débuts de la diversification des animaux.
Une grande découverte assurément, et dont l’histoire vaut le détour. Ils n’ont
pas été découverts dans les abysses, une contrée lointaine ou quelque zone
inexplorée que ce soit. Non, ils ont été découverts au fin fond… d’un aquarium
dans un laboratoire en 1883. Pendant plusieurs années (décennies, une siècle) d’ailleurs personne n’en
avait trouvé de sauvages. Puis, aussi petits et discrets soient-ils, ils ont
finalement été trouvés en liberté,
libres et heureux, en 1989 à Hawaï, dans les eaux côtières.
Cependant, malgré
les implications que cet animal pouvait avoir sur notre compréhension de
l’origine des animaux, le pauvre placozoaire est resté peu étudié. Ce n’est que
dans les années 70 que le vrai boulot a commencé. Les premiers travaux en
microscopie électronique ont été menés sur cet animal. Et donc l’année dernière
que savions-nous encore sur cet animal ? Que seuls quatre types
cellulaires sont présents. Très peu donc. En voici la liste :
-Les cellules
dorsales ciliées,
-Les cellules
ventrales, elles aussi ciliées mais présentant des papilles (pour être exact
des microvillosités),
-Les cellules
glandulaires (sécrétrices de trucs qu’on sait pas c’est quoi)
-Et des cellules
fibreuses.
Les cellules
fibreuses étaient supposées participer à la contraction de l’animal, les
cellules ciliées à sa locomotion, mais les cellules ventrales étaient aussi
supposées participer à la digestion. En effet, les microvillosités sont souvent
impliquées dans cette fonction. Or le placozoaire mange en formant une cavité
avec sa face ventrale autour des particules qu’il trouve intéressantes (ou du
moins qui ne vont pas plus vite que lui). Bref, ce n’est pas folichon, et même
la reproduction sexuée n’a jamais été observée chez cet animal (quand bien même
elle est très très fortement suspectée). Il n’y a donc pas grand-chose à dire
sur placoco. Pas grand-chose, vraiment ? Ben comme je l’ai dit on a
séquencé son génome. 98 millions de paires de bases, un océan d’informations (quand
bien même ça reste inférieur aux mammifères par exemple qui ont autour de
deux/trois milliards de paires de bases). Et ce n’est pas de l’ADN tout pourri
avec que des trucs qui servent à rien, on y trouve la plupart des gènes de développement
et de voies de signalisation cellulaires que l’on trouve chez les animaux apparemment
plus complexes comme l’humain ou la mouche ! Mais à quoi cela peut-il bien
servir chez un animal qui possède quatre types de cellules différentes et qui
ne fait rien que ramper ?
 |
|
|
La fin du résumé
de l’article suivant le séquençage du génome de notre timide placozoaire laisse
présager quelque chose. Il est écrit que cette étude devrait
« encourager des recherches plus approfondies pour une complexité
cellulaire cachée et/ou des phases du cycle de vie inconnues.» Six ans après,
enfin, certains scientifiques s’y sont enfin penchés.
Notre placoco a maintenant
été étudié dans l’océan, et si d’autres phases du cycle de vie ne sont pas à
exclure, il semble assez difficile de les observer. Rien à se mettre sous la
dent donc par rapport à d’autres phases. Alors ? D’autres types
cellulaires ? Notre ami a pourtant déjà été étudié en détails par
microscopie électronique, une méthode si puissante que la résolution est
moléculaire ! Qu’attendre de plus ?
Et bien en juillet
dernier, un article qui m’a beaucoup touché en tant que morphologiste est paru.
Une nouvelle étude de la morphologie des placozoaires. Après plusieurs articles
parus ces dernières années commentant le génome de notre ami, discutant les
implications que peuvent avoir tous ces gènes, des gens se sont enfin décidés à
revenir un peu sur la morphologie de notre ami. En morphologie, on ne prend pas
juste un organisme pour le foutre sous le microscope, faire un dessin et
décrire tout ça dans un vieux livre en allemand. Pour chaque type de
microscopie un peu avancée, on doit « fixer » l’animal. Le stabiliser
chimiquement pour ne pas qu’il se détériore, qu’il garde son intégrité
morphologique (ou génétique) et qu’il puisse être traité avec les méthodes de coloration
adaptées au microscope que l’on va utiliser. Chaque méthode de fixation a ses
avantages et ses inconvénients : l’alcool préserve l’ADN mais dessèche
l’animal. Le formol préserve sa morphologie mais l’ADN est ensuite difficile à
récupérer. Il existe des dizaines de « fixatifs », autant dire que
bien choisir est crucial. Dans cette étude récente les auteurs ont tenté des
méthodes de fixations plus efficaces, jamais essayées sur placoco, ainsi que des types de
microscopie pour certains datant de plusieurs dizaines d’années (contraste de
phase différentiel) ou plus récents (confocal) ainsi que la bonne vielle microscopie
électronique à transmission. Et ben, et on trouve quoi alors ?
Pas moins de deux
nouveaux types cellulaires ! Contre, je vous le rappelle, quatre décrits
auparavant. C’est-à-dire qu’au moins un tiers de l’animal était inconnu !
C’est comme étudier un humain des pieds au torse ! Qu’a-t-on donc
découvert ? Le plus impressionnant, bien que ces cellules ne soient pas
tellement abondantes, sont les cellules cristallines réfringentes, c’est-à-dire des cellules
qui réfléchissent la lumière au microscope. Elles possèdent en leur sein un
cristal de composition inconnue. La fonction de ces cellules est encore
énigmatique et elles pourraient éventuellement être impliquées dans la détection
de la lumière ou de la gravité. Malheureusement, pour l’instant, la sensibilité
à ces deux variables des placozoaires n’est pas attestée, et ces cellules cristallines
restent mystérieuses.
Cela ne nous
apprend donc pas grand-chose malheureusement. L’autre catégorie de cellules
trouvée est celle des cellules lipophiles (c’est-à-dire qu’elles contiennent
des lipides, du gras quoi), autrement plus intéressantes puisqu’elles semblent secréter
des produits acides. Au vu de leur répartition sur la phase ventrale, elles
sont supposées participer à la digestion par la sécrétion des différents
produits. Des cellules non négligeables donc. Rappelez-vous, lorsqu’un
placozoaire mange, il forme seulement une cavité avec sa face ventrale. Il est
donc supposé que ces cellules lipophiles vont relarguer les « sucs
digestifs ». La « proie » (si tant est que placoco chasse) va
être digérée, et les cellules ciliées ventrales, avec leurs microvillosités et
donc leur surface augmentée, vont s’occuper de l’absorption des nutriments. La
question est : cela pourrait-il nous apprendre quelque chose sur l’origine
même du système digestif chez les autres animaux ? Qui sait ? Mais
plus de recherches sont nécessaires pour pouvoir s’approcher d’une conclusion.
 |
Représentation d’une coupe de placozoaire avec les
nouveaux types de cellules découverts. En plus d’être plus complet, ce dessin
est plus joli que ce qu’on avait précédemment. DEC et VEC signifient
respectivement cellule de l’épithélium dorsale et cellule de l’épithélium
ventral. Source : Smith et al. 2014.
|
Allez, voilà, on
a fait le tour des deux autres types de cellules. C’est proportionnellement
plus mais pas la peine de faire tout un foin là-dessus. Mais si ! Quand
y’en a plus y’en a encore (je n’en ai cependant plus pour très longtemps). Déjà,
deux autres types de cellules supplémentaires pourraient être présents. Ca
n’est pas encore confirmé car on n’a pas tellement de nouvelles données, c’est
pour ça qu’elles ne font pas encore partie de la liste « officielle ».
Certaines études précédentes ont montré la présence de cellules dorsales
ciliées apparemment similaires en morphologie des bonnes vieilles cellules dorsales déjà décrites, mais possédant aussi des lipides
en leur sein. Ces cellules ont été supposées être impliquées dans la défense de
l’organisme (elles seraient répulsives). Malheureusement les spécimens étudiés
dans cette nouvelle étude ne semblaient pas présenter ces gouttelettes de
lipides. Cela laisse supposer que la lignée de clones sur laquelle l’étude a
été menée est différente des lignées sauvages. Et des observations des auteurs
sur les lignées sauvages ont confirmé la présence de ces gouttelettes de
lipides.
Le dernier type
de cellules supposé est peut-être constitué par des cellules souches, c’est à
dire des cellules indifférenciées. Malheureusement, ces petites cellules
reportées dans d’autres études ne sont pas vraiment discutées dans cette étude…
Donc, peut-être huit
types de cellules, c’est bien. Mais attendeeeeez, j’ai toujours pas fini !
L’étude plus approfondie de la morphologie des cellules déjà décrites peut nous
apporter aussi de nouvelles informations. Et ça a été le cas. Déjà les cellules
glandulaires dont je vous parlais semblent produire des neurotransmetteurs… Ce
seraient donc des cellules impliquées dans l’intégration des informations que l’organisme
perçoit autour de lui. Probablement des cellules similaires aux cellules
nerveuses des autres animaux. Une découverte importante qui encore, demande
plus de recherches. On est loin de la fonction inconnue de ces cellules, quand
bien même il reste du travail.
Le dernier
résultat intéressant, c’est que ces cellules fibreuses n’auraient pas le rôle
contractile qu’on leur a précédemment prêté. Quand bien même leur morphologie correspond,
il n’a pas été trouvé de fibres contractiles. A l’inverse, au contact de chaque
cellule, au niveau de la membrane cellulaire, des pores sont présents. Ce qui
laisse penser que des trucs, encore inconnus, doivent passer entre les
cellules. Les auteurs ont donc proposé que ce seraient peut-être plutôt des
cellules qui transmettent de l’information, des formes de
« neurones » (bien que ça n’en soit pas, il n’y a pas de vraie
synapses). Bref, encore une piste à explorer, d’autant plus qu’il y a une
question en suspens maintenant, c’est que si les cellules fibreuses ne sont pas
contractiles, alors comment les placozoaires se contractent-ils ?
Allez, un petit
récapitulatif :
|
Type de cellule
|
Fonction
supposée
|
Anciennes cellules décrites
|
Cellules ciliées dorsales
|
Déplacement
|
Cellules ciliées ventrales
|
Déplacement et ingestion
|
Anciennes cellules décrites et réinterprétées
|
Cellules glandulaires
|
Précédemment
inconnu, probablement Neurosécrétion.
|
Cellules fibreuses
|
Contraction. Transmission de signal hormonal ou électrique
|
Nouvelles cellules décrites
|
Cellules lipophiles (ventrales)
|
Digestion
|
Cellules cristalines
|
Inconnue (vision, balance ?)
|
Nouvelles cellules suspectées
|
Cellules
lipophiles dorsales
|
Défensive ?
|
Cellules
souches
|
Cellules
non spécialisées
|
Tableau
récapitulant les nouvelles découvertes morphologiques sur notre ami placoco
Donc si on résume
bien, on a deux extrêmes :
-Soit on a
seulement découvert deux nouveaux types de cellules, ce qui nous fait au total six
types de cellules.
-Ou, on a jusqu’à
quatre nouveaux types de cellules, ce qui double le nombre précédemment décrit,
et la moitié de ce qui était précédemment décrit (deux sur quatre) était mal
interprétée. C’était donc, dans ce cas, plus de trois quarts de la morphologie
qui était inconnue ou mal décrite.
Encore une fois à
l’ère de la génomique, si en effet, les trois quarts de la morphologie étaient
inconnus, les interprétations sur cet animal et son génome étaient donc là
jusque-là quasiment vides de sens. Six ans après le séquençage du génome des
placozoaires et plusieurs articles sur le sujet, il était temps de revenir un
peu sur leur anatomie. Tout ça montre donc l’importance de la morphologie en
biologie. Ce n’est pas une vieille discipline dont on n’a plus besoin. C’est
une activité dynamique où les techniques se multiplient mais aussi où une
quantité incroyable de travail reste à faire (sur des organismes déjà étudiés
ou non, avec des méthodes déjà utilisées ou non). A l’inverse malheureusement,
le nombre de spécialistes dans ce domaine diminue fortement.
Bien sûr, encore
une fois, la prudence est de mise. Certaines des conclusions que j’ai évoquées
ici pourraient être réinterprétées… Mais dans tous les cas, même le plus « insignifiant »
des animaux a encore beaucoup de secrets à nous révéler !
Sources :
Smith, C., Varoqueaux, F., Kittelmann, M., Assam, R. N.,
Cooper, B., Winters, C. A., Eitel, M., Fasshaeur, D. et Reese, T. S. Novel cell
types, neurosecretory cells, of the early-diverging Metazoan Trichoplax adherens. Current Biology.
24, 1565-1572.
Srivastava, M., Begovic, E., Chapman, J., Putnam, N.H.,
Hellsten, U., Kawashima, T., Kuo, A., Mitros, T., Salamov, A., Carpenter, M.L.,
et al. (2008). The Trichoplax genome
and the nature of placozoans. Nature.
454, 955–960.